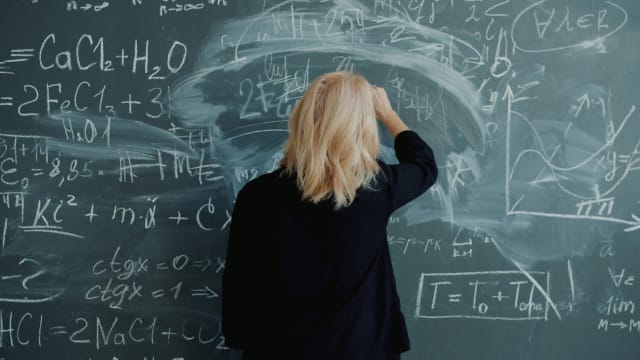Longues journées de travail, peu de soutien de la part de la hiérarchie, lacunes dans l'organisation, manque de repères, manque de considération: les griefs souvent exprimés par les médecins assistants suisses préoccupent tout autant les «internes» français. Chez nos voisins, les enquêtes menées auprès des jeunes médecins révèlent une charge de travail problématique à bien des égards.
Une
enquête réalisée au printemps par l'association ISNI a révélé que les jeunes médecins hospitaliers travaillent en moyenne 59 heures par semaine. Cette surcharge de travail est directement liée à des problématiques telles que les démissions et le burn-out, tout aussi fréquentes dans l'Hexagone.
Pour mieux comprendre comment les internes français gèrent cette situation, une étude sociopsychologique leur a été consacrée. Les chercheuses en gestion et management Marie Cousineau et Adama Ndiaye ont d'abord mesuré le risque et le taux de burnout de 242 internes d'un groupe hospitalier régional. Elles se sont ensuite intéressées aux jeunes médecins qui ne présentaient aucun signe de surmenage, soit environ la moitié de la population interrogée. Une série d’entretiens a été menée pour explorer leurs stratégies d’adaptation et comprendre comment ils faisaient face aux difficultés.
L'analyse d'Adama Ndiaye et de Marie Cousineau a mis en évidence quatre approches principales:
Se concentrer sur l'avenir, «Les projectionnistes». Ces internes trouvent un échappatoire mental en se tournant vers l’avenir, en envisageant par exemple un projet professionnel ou personnel. Certains mentionnent des séjours à l’étranger ou des perspectives après la fin de leur formation.
L’un d’entre eux explique: «Si j’arrive à ne pas être en souffrance, c’est parce que j’ai mon activité personnelle en médecine chinoise qui me donne un élan. J’ai des projets pour l’avenir, je suis déjà ouvert sur la suite.»
Les «conformistes». Malgré les difficultés éprouvées, ces internes considèrent leurs conditions de travail comme normales, voire comme nécessaires à leur progression. Pour eux, les journées de travail prolongées constituent un atout, puisqu'elles offrent une excellente opportunité de formation. Ils ne remettent pas le système en question.
Ainsi, un des participants témoigne: «Il n’y a jamais des moments où je me dis « mon dieu, j’ai trop de trucs à faire, je ne vais pas y arriver, je suis débordé par le travail », là ça ne m’arrive plus maintenant, ça m’est arrivé. J’arrive plus facilement à gérer plus de choses. Dans l’internat, il y a une courbe de progression. Il y a un moment où on ne sait pas. L’expérience venant, les choses se répétant c’est relativement un peu tout le temps pareil. On sait plus facilement vers quoi s’orienter, les gestes, on les fait plus vite, on a plus d’assurance, on se pose moins de questions.»
Les «internes» sont, dans le système médical français, équivalents aux médecins assistant.e.s de notre pays: Ils se situent à un niveau de formation qui suit la fin de la sixième année d'études et dure de trois à cinq ans.
«Les autoconnaisseurs», ou l'optimisation de soi. Ces internes voient dans la pratique de la médecine un moyen de mieux connaître leurs limites. Ils abordent les difficultés non pas comme un obstacle, mais comme un moyen de se développer et de se distinguer de leurs collègues. Ils peuvent par exemple chercher à se perfectionner dans un domaine afin d'aider et d'épauler les autres.
L’un d’eux confie: «Je pense que je suis assez utile parce que mon parcours atypique est une force extraordinaire que j’ai sous-estimée au début. Je n’ai pas les mêmes connaissances que les autres médecins, notamment en statistiques, donc je peux donner des conseils que même les chefs ne pourraient pas.»
Les «challengers». Ces internes adoptent une approche ludique de leur formation, transformant chaque journée en une série de défis.
Un des paricipants déclare: «Pour moi les urgences, c’est une sorte de jeu. Tous les jours je viens, un patient arrive qu’est-ce qu’il a ? Il faut que je trouve, c’est mon petit jeu ! Qu’ils ne disent pas merci derrière je m’en fiche, chaque patient c’est une épreuve pour moi de tester mes connaissances et de m’améliorer. Je deviens un meilleur médecin chaque jour. Ça me plaît et ça me suffit largement.»
Pour Marie Cousineau et Adama Ndiaye, ce modèle met en lumière plusieurs stratégies de résilience qui peuvent apporter des repères aux jeunes médecins : «Cette typologie montre que la connaissance de soi est une alliée qui permet d’adopter des stratégies pour faire face aux difficultés du terrain.» Avant d'ajouter: «Cette aptitude est une protection mentale permettant de gérer ses efforts et sa relation au travail.»