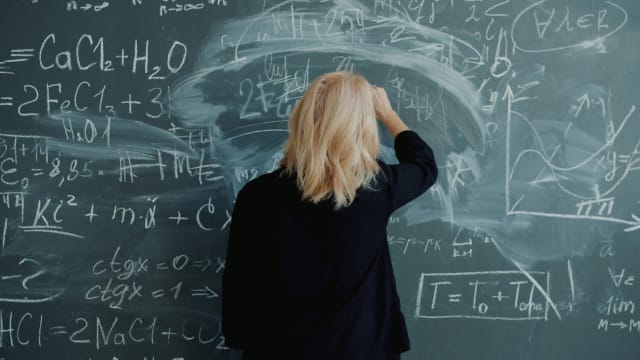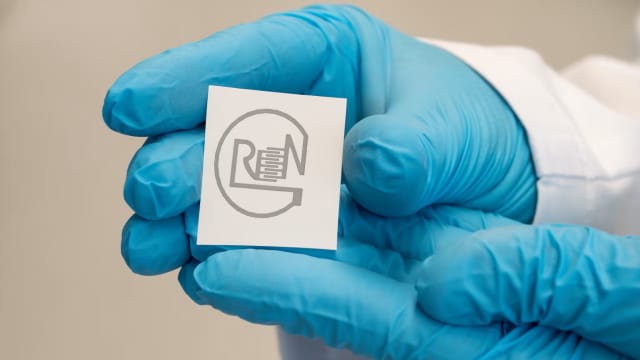La comparaison des performances sous forme de classements peut contribuer à promouvoir la qualité des soins médicaux – à condition que cette méthode soit utilisée avec discernement. C’est ce que démontre une récente étude d’économie de la santé, publiée dans la revue «Management Science».
Quel est l’intérêt pour des médecins de s’évaluer mutuellement au sein d’une équipe hospitalière? Une telle démarche améliore-t-elle les performances et la qualité des soins? Ou au contraire, engendre-t-elle un effet démotivant? Une équipe de chercheurs des universités de Cologne et de Münster s’est penchée sur la manière dont les médecins réagissent à différentes formes de classement, lorsque la qualité de leur traitement individuel est évaluée.
Les recherches en économie comportementale ont déjà montré à plusieurs reprises que ce type de système de feedback, intégrant une reconnaissance par les pairs, peut avoir un effet stimulant – à condition que les critères soient transparents et réalistes. En revanche, si les objectifs paraissent inatteignables, la démotivation peut s’installer.
Dans le cadre d’une expérience dite «Lab-in-the-Field», menée auprès de plus de 100 médecins en activité et 240 étudiants en médecine, les chercheurs ont analysé l’impact de différents seuils de classement sur les performances individuelles.
Les résultats montrent qu’il n’existe pas de modèle unique pour renforcer la motivation. Les classements doivent être adaptés aux performances réelles de l’équipe.
«Le défi est de trouver le bon équilibre pour motiver le plus grand nombre possible de médecins, sans en décourager d’autres»,
explique Yero Ndiaye, co-auteur de l’étude. Selon lui, il s’agit de créer pour tous les membres de l’équipe une perspective d’amélioration à la fois réaliste et accessible.
Recommendations pratiques
L’étude débouche sur une recommandation claire à destination des directions hospitalières: pour que les classements soient un outil de feedback efficace, il faut à la fois mesurer les performances individuelles et proposer des formations ciblées, permettant aux professionnels de progresser.
Ce n’est que dans ces conditions que les retours sur performance peuvent avoir un réel impact – et que les classements deviennent un levier durable d’amélioration de la qualité des soins.
«Une mise en œuvre réussie dans la pratique clinique suppose la collecte régulière de données individuelles de performance, ainsi que l’intégration systématique de feedbacks accompagnés de possibilités de formation et de perfectionnement», résume Daniel Wiesen, responsable de l’étude à l’université de Cologne. Il précise toutefois: «Des études complémentaires, menées sur le long terme et dans des conditions cliniques réelles, restent nécessaires pour confirmer ces résultats.»