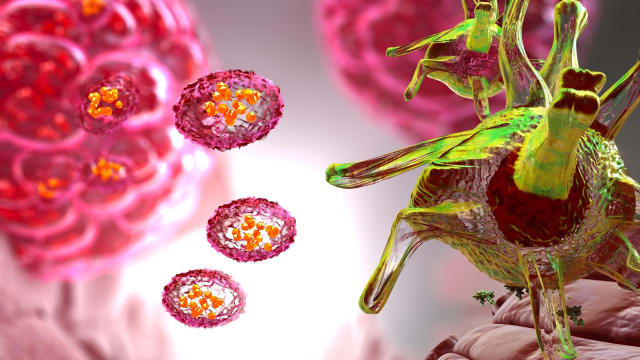Madame Gyuriga Perez, qu’est-ce qui vous a motivée à devenir infirmière?
Dès le départ, c’est la relation humaine qui m’a attirée. Il y avait une dimension sociale, une envie d’être utile concrètement. Ce qui m’a fascinée, c’est aussi l’alliance entre savoirs scientifiques et application pratique – et puis, bien sûr, le travail en équipe.
Votre parcours vous a mené bien au-delà du lit du patient. Vous êtes aujourd’hui la première infirmière cantonale de Suisse. Ce poste reste-t-il unique?
Quand j’ai pris mes fonctions en 2022, c’était effectivement unique en Suisse. Aujourd’hui, d’autres cantons suivent – Lucerne a nommé une infirmière cantonale, le Valais est en train de recruter. Ce rôle, inspiré de modèles recommandés par l’OMS, permet d’agir à un niveau stratégique et politique. Dans mon cas, je suis directement rattachée à la direction générale de la santé et je travaille sur les professions de soins et de santé dans leur ensemble – sauf les professions médicales. Cela comprend le développement de ces professions, la pénurie, les besoins en formation et l’autonomie professionnelle.
Teresa Gyuriga Perez est Infirmière cantonale du Canton de Vaud depuis 2022. Infirmière clinicienne de formation, elle est titulaire d'un Master en management stratégique des institutions de santé. Elle a été infirmière cheffe de l'Hôpital de l'enfance du département femme mère enfant du CHUV et a coprésidé la section vaudoise de l'ASI.
Parlons justement des défis: quel est, selon vous, le principal obstacle auquel fait face la profession?
On cite souvent la pénurie, mais pour moi, un des enjeux, c’est la pleine utilisation des compétences infirmières. Les professionnels sont très bien formés, mais leur champ d’action peut être parfois limité par une incompréhension du rôle et par des représentations dépassées. Il faut casser ces stéréotypes persistants. L’image d’une infirmière subordonnée ou exécutante n’existe pas, ceci dit elle est encore très présente, y compris dans l’inconscient collectif.
C’est précisément ce que vous reprochez au film «En première ligne», qui met en scène une infirmière débordée, voire impuissante. Qu’avez-vous pensé de ce portrait?
Le jeu de l’actrice est remarquable, le travail de la réalisatrice également et certaines scènes sont réalistes – la surcharge, la fatigue, le manque de soutien. Mais le film simplifie la réalité. Il concentre toutes les complications possibles en une nuit, ce qui nuit à la crédibilité, On voit une infirmière qui subit, qui court, qui s’effondre, alors qu’en réalité, elle a des compétences cliniques, un jugement autonome, une capacité à prioriser, désamorcer, intervenir. Tout cela n’est pas montré.
Y a-t-il une scène qui vous a particulièrement dérangée?
Oui, celle où elle court après un médecin qui ne l’écoute pas. Ce genre de situation peut arriver, mais c’est loin d’être la norme. Dans la plupart des cas, les infirmières sont entendues et écoutées et travaillent en binôme avec les médecins avec un partage de responsabilité. Et quand on montre ce type d’interaction comme systématique, on alimente le cliché de la professionnelle dépendante, reléguée au second plan.
«On voit une infirmière qui subit, qui court, qui s’effondre, alors qu’en réalité, elle a des compétences cliniques, un jugement autonome, une capacité à prioriser, désamorcer, intervenir.»
Et d’un point de vue plus concret, certaines tâches montrées dans le film relèvent d’autres professions?
Exactement. On voit l’infirmière pousser des lits de patients, exécuter des gestes de base, elles le font parfois, mais cela relève principalement des Assistantes en soins et santé communautaire (ASSC). À l’inverse, on ne montre pas son raisonnement clinique, sa capacité d’analyse, ses responsabilités dans l’éducation thérapeutique ou la relation d’aide. Elle semble constamment agir sous délégation, alors qu’en Suisse, les infirmières prennent des décisions, portent la sécurité des soins et exercent un leadership reconnu.
Est-ce une question d’intention artistique, à votre avis?
Sans doute. Petra Volpe a voulu choquer, montrer la surcharge, provoquer l’empathie. Mais attention à ne pas figer l’image de la «pauvre infirmière» – mal payée, débordée, impuissante. Cela n’est souvent pas le cas, car elles exercent un leadership. Ce genre de représentation peut détourner les jeunes du métier, alors que c’est une profession passionnante, pleine de perspectives, avec un haut niveau de formation.
«Heldin» représente la Suisse aux Oscars
L’
Office fédéral de la culture a inscrit le film «En première ligne» (en allemand «Heldin») de l’autrice et réalisatrice Petra Volpe auprès de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Hollywood dans la catégorie «Meilleur film international». Le verdict tombera en décembre 2025 au moment de la publication de la «short list» des nominations.
Justement, que faudrait-il montrer pour susciter des vocations?
Il faut montrer l’autonomie, la diversité des rôles, la responsabilité réelle. Aux États-Unis, certaines séries suivent des nurse practitioners – des infirmières de pratique avancée. Ce sont elles les héroïnes, pas les médecins. Et cela donne envie. En Suisse aussi, les infirmières exercent des responsabilités du patient, elles dirigent des services, siègent aux comités stratégiques, innovent, prennent des décisions.
Le film montre aussi des moments plus doux, comme une scène où l’infirmière chante à une patiente atteinte de démence. Ce type de geste a-t-il réellement sa place dans la pratique?
Absolument. Ce n’est pas anodin – c’est une technique de relation d’aide. Tenir la main, chanter une chanson connue, s’adresser au patient avec douceur: ce sont des interventions thérapeutiques qui s’appuient sur des connaissances spécifiques. On ne fait pas juste «du lien» par gentillesse. Il s’agit de compétences professionnelles, acquises en formation, qui visent à apaiser, soutenir, accompagner. Cela fait partie intégrante de la pratique infirmière.
«En Suisse, les infirmières exercent des responsabilités du patient, elles dirigent des services, siègent aux comités stratégiques, innovent, prennent des décisions.»
Mais dans une nuit comme celle montrée dans le film, est-ce encore possible?
C’est justement ce que le film rend perceptible: quand la surcharge est telle, l’espace pour la relation disparaît. Et c’est une perte immense, car la relation fait partie du soin. Mais dans la réalité, les infirmières se battent pour préserver ces moments, même dans l’urgence. C’est ce qui donne du sens à leur profession.
Un dernier mot pour la réalisatrice?
Je serais curieuse de savoir qui étaient ses conseillers métier. Car son film est beau, mais c’est un instantané. Pas un documentaire. Il reflète une nuit critique, pas la richesse ni la complexité du rôle infirmier. À vouloir dénoncer une situation, on risque d’enfermer la profession dans une image réductrice – et de freiner son évolution.